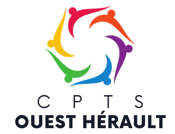Une mise à jour nécessaire dans un contexte d’errance médicale
En février 2025, la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié la première partie de ses nouvelles recommandations concernant la borréliose de Lyme et les autres maladies vectorielles à tiques. Cette mise à jour était attendue depuis longtemps, tant par les professionnels de santé que par les patients confrontés à une pathologie encore mal connue, souvent sujette à des interprétations divergentes. L’objectif affiché par la HAS est clair : offrir un cadre harmonisé, fondé sur les preuves, pour améliorer la prévention, affiner le diagnostic et garantir une prise en charge adaptée des formes précoces de la maladie, notamment l’érythème migrant.
Dans un contexte où l’errance diagnostique, les traitements inadaptés et les tensions entre discours scientifiques et croyances populaires fragilisent la relation médecin-patient, cette actualisation apporte de la rigueur, de la méthode et des repères solides. Elle repositionne aussi le rôle du médecin généraliste au cœur de la stratégie de prise en charge des formes simples, tout en clarifiant les situations nécessitant une expertise spécialisée.
Une maladie présente partout en France, avec des zones à risque accru
La borréliose de Lyme est une infection bactérienne due à Borrelia burgdorferi, transmise à l’humain par la piqûre d’une tique du genre Ixodes ricinus. En France, toutes les régions sont concernées, bien que les zones boisées de l’Est, du Centre et du Grand-Ouest soient les plus exposées. La transmission n’est pas systématique : elle dépend principalement de la durée d’attachement de la tique, généralement au-delà de 24 à 36 heures. L’incidence, bien que variable selon les années et les départements, reste significative, avec environ 51 cas pour 100 000 habitants en 2022, soit une estimation annuelle située entre 28 000 et 40 000 cas.
Cette réalité épidémiologique justifie pleinement l’accent mis sur la prévention, qui demeure la première ligne de défense face à cette maladie.
La prévention : un pilier fondamental, basé sur des gestes simples
La HAS rappelle que la prévention repose avant tout sur des mesures mécaniques et comportementales. Lors de toute activité en forêt, dans les hautes herbes ou dans des zones à risque, il est recommandé de porter des vêtements longs, couvrants et de couleur claire, qui permettent de repérer plus facilement les tiques. L’utilisation de répulsifs à base d’icaridine ou de DEET, homologués avec une autorisation de mise sur le marché, est également recommandée, y compris chez les enfants ou les femmes enceintes, à condition de respecter les précautions d’usage.
Une fois de retour à domicile, l’inspection minutieuse de tout le corps, y compris les zones difficiles à voir comme les plis de peau, est indispensable. Si une tique est détectée, elle doit être retirée le plus rapidement possible à l’aide d’un tire-tique spécifique, sans produit anesthésiant ni éther. Une désinfection locale est de mise, suivie d’une période d’observation d’un mois. Contrairement à certaines idées reçues, ni la sérologie immédiate, ni l’antibioprophylaxie ne sont indiquées à ce stade.
Diagnostic : un trépied clinique, contextuel et sérologique
Pour éviter les diagnostics abusifs ou erronés, la HAS insiste sur un schéma en trois temps. Le diagnostic doit s’appuyer sur la notion d’exposition à un environnement à risque, la présence de signes cliniques compatibles et, dans les formes disséminées, sur une confirmation biologique par sérologie. L’érythème migrant constitue la forme localisée précoce typique : il s’agit d’une plaque rouge, s’élargissant progressivement autour du point de piqûre, souvent indolore mais très caractéristique.
Dans ce cas précis, le diagnostic est exclusivement clinique. Les tests sérologiques ne sont pas pertinents à ce stade, car ils sont souvent faussement négatifs. Le traitement doit être initié sans attendre. Il repose, chez l’adulte, sur l’administration de doxycycline 100 mg deux fois par jour pendant 10 jours, voire 14 jours si plusieurs érythèmes sont présents. Pour les enfants ou les femmes enceintes, on privilégie l’amoxicilline, à des posologies adaptées à l’âge et au poids.
Que faire en cas de formes disséminées ou atypiques ?
Lorsque la maladie évolue ou que le diagnostic est posé à un stade plus avancé, la stratégie thérapeutique devient plus spécifique. Les formes disséminées peuvent se traduire par des atteintes neurologiques (méningite, paralysie faciale), articulaires (arthrites), cardiaques (troubles du rythme) ou même ophtalmologiques. Dans ces cas-là, une sérologie positive est indispensable pour poser le diagnostic.
Le traitement dépend alors de la nature et de la gravité des symptômes. Il peut inclure des antibiotiques par voie orale ou intraveineuse, comme la ceftriaxone, selon des protocoles bien définis. L’efficacité du traitement est généralement bonne si la prise en charge est précoce. Il n’est pas nécessaire de contrôler la sérologie après le traitement. En revanche, si les symptômes persistent malgré une antibiothérapie adaptée, le patient doit être orienté vers un centre de compétence ou de référence dédié aux maladies vectorielles à tiques. Ces structures permettent une prise en charge multidisciplinaire, évitant le piège des traitements prolongés injustifiés ou des diagnostics alternatifs non fondés.
Une prise en charge centrée sur le bon sens clinique et la spécialisation progressive
Avec ces nouvelles recommandations, la HAS redéfinit une ligne de conduite claire, accessible à tous les professionnels de santé. Le message est simple : lorsqu’il y a suspicion de forme simple comme un érythème migrant, le médecin traitant est parfaitement légitime pour poser le diagnostic et initier le traitement, sans avoir besoin d’investigations supplémentaires.
Ce n’est que dans les formes complexes, disséminées ou persistantes, qu’un avis spécialisé devient pertinent. Cette clarification devrait contribuer à désengorger les structures hospitalières tout en offrant aux patients un parcours de soins plus cohérent, plus rapide et plus sécurisé.
En attendant la partie 2 : cap sur les formes chroniques
La deuxième partie des recommandations est attendue prochainement. Elle devrait aborder la prise en charge des complications tardives, des formes chroniques suspectées, ainsi que des cas atypiques souvent au cœur des controverses. Cette suite est particulièrement importante pour mieux accompagner les patients souffrant de symptômes prolongés, parfois invalidants, et souvent en rupture avec le système de soins.
D’ici là, les professionnels sont invités à s’approprier ces nouvelles directives, à les appliquer au quotidien et à participer activement à une meilleure compréhension de la maladie de Lyme. La prévention, le bon sens clinique, une antibiothérapie adaptée et une orientation raisonnée constituent les piliers de cette prise en charge renouvelée.